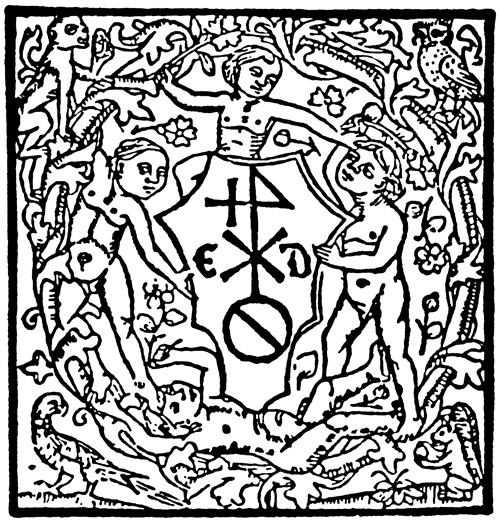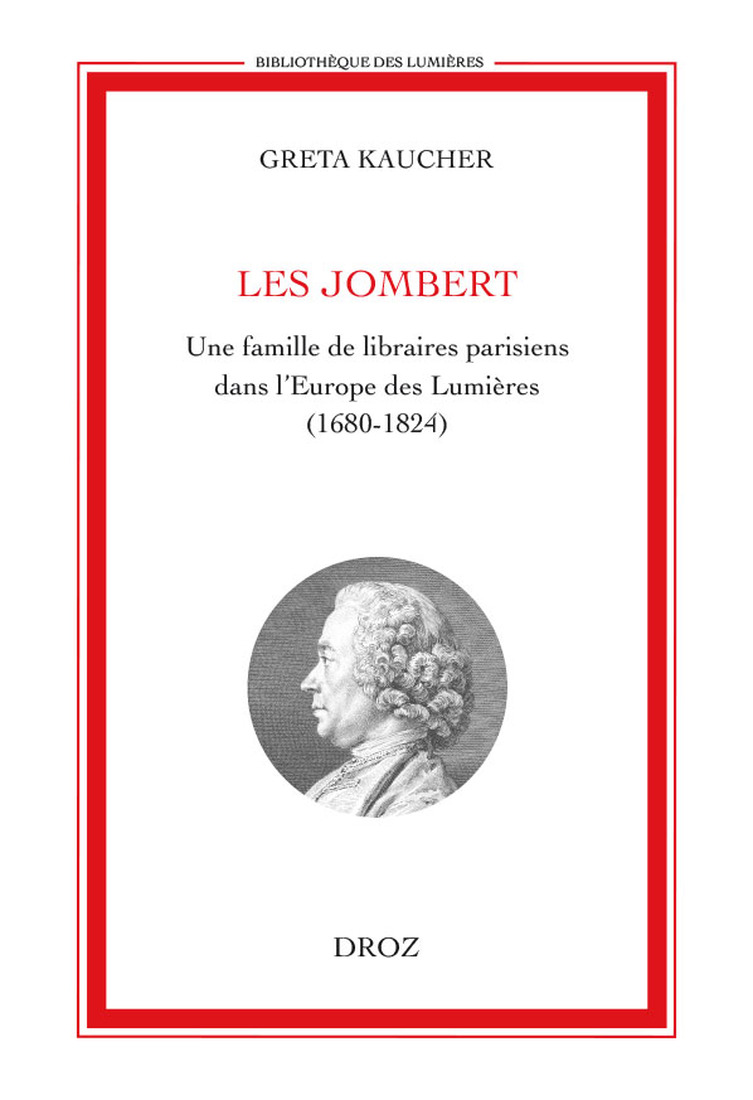XVIIIe siècle
Table des matières
Remerciements
Table des abréviations
Table des ouvrages cités en abrégé
Table des bibliothèques et institutions citées en abrégé
Introduction
Première partie
1680-1735 : Les débuts d’une dynastie
Chapitre premier
L’entrée en librairie : la trajectoire de Jean I Jombert (1643-1705)
Chapitre II
Une transition plutôt modeste : Claude Jombert (1679-1735)
1. L’ancrage d’une famille dans le Paris du livre : adresses, enseigne et marques
2. Une dynastie précocement liée à l’Académie des sciences
3. Un projet de publication avorté avec un auteur mauriste orléanais
Deuxième partie
L’affirmation d’une lignée professionnelle au siècle des Lumières
Un libraire du Roi placé au premier rang de sa profession
Chapitre III
Le métier de libraire d’assortiments
1. La librairie d’assortiment et ses enjeux
2. En France et à l’étranger : jalons pour un large réseau de correspondants
3. Le faible volume des envois transmis par la douane de Paris
Chapitre IV
Charles-Antoine Jombert et l’Académie des sciences
1. L’implication de Charles-Antoine Jombert dans la querelle des forces vives
2. Les auteurs académiciens : transfuges et recrues de choix
Chapitre V
Le réseau d’auteurs : liens étroits et tensions éventuelles
1. Des relations privilégiées avec nombre d’auteurs
2. De quelques litiges et tensions avec les auteurs
3. Le crédit auprès de la direction de la Librairie et la tentation de l’arbitrage
Chapitre VI
Patrimoines familiaux et éléments de train de vie
1. Charles-Antoine Jombert : un univers matériel opulent
2. Présence des arts, des sciences et des loisirs de société
3. Des caractéristiques et constantes familiales
4. Gens de Maison
Troisième partie
Un apogée : Charles-Antoine Jombert et les années 1750-1770
Chapitre VII
Lieux de vie, espace professionnel, sociabilité et reconnaissance corporative : les marques d’une consécration
1. Charles-Antoine Jombert et l’hôtel Impérial de la rue Dauphine
2. L’espace professionnel : Charles-Antoine Jombert et son personnel de boutique
3. De Claude à Claude-Antoine Jombert : l’importance des résidences secondaires
4. Le salon de Jombert : « le chef-lieu de la Librairie des Sciences et des Arts »
5. La reconnaissance corporative
Chapitre VIII
L’imprimerie de Charles-Antoine Jombert
1. De Paris à la province : l’organisation de la sous-traitance typographique
2. Vue générale jusqu’en 1753
3. Charles-Antoine Jombert imprimeur (1754-1759)
4. A partir de 1760 : une étroite collaboration avec le gendre imprimeur Louis Cellot
5. Autres collaborations nouées ou continuées par les fils de Charles-Antoine Jombert
6. Les leviers imprimés du commerce : placards, prospectus et annonces
Chapitre IX
Une entreprise éditoriale
1. Pour une vue d’ensemble : statistiques de la production éditoriale des Jombert
2. Aperçus qualitatifs tirés de l’enquête statistique
3. Partenariats et stratégies confraternelles
4. Initiatives, exigences et genèses éditoriales
5. La valeur ajoutée éditoriale : un chantier dont le libraire éditeur est le maître d’oeuvre
6. L’enjeu capital des traductions et des traducteurs
7. Le travail de la « mise en livre » à travers les paratextes (épîtres, préfaces, avis, pièces liminaires)
8. Charles-Antoine Jombert, marchand et éditeur d’estampes ?
Chapitre X
Repères pour la réception : catalogues, recensions et autres témoignages
1. Les catalogues : un instrument de diffusion particulièrement efficace dans un contexte de spécialisation éditoriale
2. Critiques, recensions, mémoires et correspondances
Quatrième partie
Charles-Antoine Jombert et les arts
Chapitre XI
Iconophile et collectionneur
1. Une importante collection personnelle
2. Les ventes aux enchères d’estampes (Boucher, Fabre et Huquier) et l’« oeuvromanie » de Charles-Antoine Jombert
Chapitre XII
Historien de l’art et iconographe : travaux et recherches
1. Un historien de l’art fort de son expérience d’éditeur-auteur
2. Catalogue de Charles-Nicolas Cochin (1770)
3. Catalogue de Stefano Della Bella (1772)
4. Catalogue de Sébastien Leclerc (1774)
5. Le projet non abouti du catalogue de Jacques Callot
6. La collaboration au Dictionnaire des artistes de Carl Heinrich von Heinecken
Chapitre XIII
Amitiés artistiques
1. Une relation particulière : Mme Jombert – Charles-Nicolas Cochin – M. Jombert
2. Aignan-Thomas Desfriches et sa famille : séjours et liens orléanais
3. Echanges, services amicaux et vie quotidienne
4. Les portraits de Charles-Antoine Jombert et de Marie-Angélique Guéron
Cinquième partie
Fin d’une dynastie
Chapitre XIV
Charles-Antoine Jombert et sa descendance directe
1. Descendance du premier lit
2. Descendance du second lit
Chapitre XV
Vente du fonds et retraite de Charles-Antoine Jombert (1775-1779)
Chapitre XVI
Les descendants de Charles-Antoine Jombert et les métiers du livre
1. Marie-Angélique Jombert et Louis Cellot
2. Claude-Antoine Jombert et Marie-Madeleine Deschamps
3. Louis-Alexandre Jombert et Marguerite-Charlotte Didot
4. Louis-Marie et Louis-Toussaint Cellot
5. Autres successeurs de la maison Jombert
6. Louis-Antoine Jombert, libraire de Stendhal et la « Librairie Lexique »
Chapitre XVII
Le peintre Pierre-Charles Jombert ou le rêve comblé d’une famille tournée vers les arts ?
Chapitre XVIII
Antoinette-Sophie Jombert (1783-1861) et ses descendants : Charpentier, Lemonnier et Robida
Chapitre XIX
Les descendants de Louis-Alexandre Jombert et le professorat
Conclusion
Catalogue raisonné de la production éditoriale des Jombert
Normes utilisées pour la rédaction du catalogue raisonné
Annexes
Annexes iconographiques
Sources et bibliographie
Index des titres
Index topographique et des institutions
Index onomastique
Table des illustrations
Table des tableaux insérés dans le texte
Table des annexes
Première étude d’ensemble consacrée à la dynastie Jombert, libraires, éditeurs et imprimeurs de sciences et d’art à Paris de 1680 à 1824, à l’enseigne « A l’Image Notre-Dame », dont le plus illustre représentant, Charles-Antoine Jombert (1712-1784), fut nommé « libraire du Roi pour l’artillerie et le génie ». À la lumière d’un grand nombre d’archives inédites sont analysés tout à la fois : les relations de ces professionnels avec les acteurs du livre de leur temps ; les mécanismes éditoriaux et leurs supports ; les sociabilités scientifiques et artistiques qu’ils ont animées, s’appuyant notamment sur une relation privilégiée avec Charles-Nicolas Cochin ; ainsi que les activités iconographiques de Ch.-A. Jombert et celles de son fils, le peintre Pierre-Charles Jombert. Cette étude est suivie du catalogue raisonné de toute la production éditoriale de cette famille, riche de 992 notices bibliographiques détaillées, particulièrement utile aux professionnels du monde du livre ancien, bibliophiles et chercheurs en histoire des sciences et de l’art, dans leur travail d’identification et de documentation.
Pour la distribution en France : www.sodis.fr
À l’aube des temps modernes, les monarchies espagnole et française se profilent comme les deux plus puissantes d’Europe occidentale. Rivales, elles sont néanmoins liées par d’innombrables liens, politiques et culturels. La volonté de s’affirmer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs états, impose à leurs princes de s’appuyer sur des individus capables de rendre visible, voire présente, leur autorité et leur dignité. Les vice-rois hispaniques, comme les gouverneurs français, ont alors pour mission de représenter l’autorité royale dans des lieux éloignés de la cour, où le roi ne peut être présent. L’affirmation de la majesté, de plus en plus individualisée dans la personne du souverain, semble métamorphoser le rôle de ces lieutenants territoriaux, jadis simples agents, en de véritables images reflétant la personne même du souverain. À l’étranger, cette fonction incombe aux ambassadeurs ainsi revêtus de « la gloire du roi ». Le faste, le cérémonial, les images, la gestualité et la parole, constituent les instruments de cette mission : tenir la place du roi en son absence.
Table des matières
Préface
C. Le Blanc et L. Simonutti
INTRODUCTION
Philosophie, traduction, histoire
C. Le Blanc
Renaissance, Contre-Réforme et Siècle des Lumières : tradition et traduction
M. Vittori
DU TEXTE A LA PENSÉE
Les réflexions humanistes sur la traduction
Humanisme et traduction durant la Contre-Réforme - Girolamo Catena
S.U. Baldassarri
Luther et la germanisation de la Bible
I. Ferron
Ronsard, apologiste de la liberté de traduire
J.-K. Sohn
Les traductions humanistes
Ficin traducteur de Psellus
F. Dell’Omodarme
La Boétie et Montaigne : La Mesnagerie de Xénophon et la « légende socratique »
R. Ragghianti
Montaigne traducteur de Sebond
N. Panichi
Jean Calvin et l’hébreu
M. Engammare
La version hébraique abrégée des Voyages de Jean de Mandeville réalisée par Yohanan Alemanno
F. Lelli
Le De interpretatione de Pierre-Daniel Huet : entre tradition humaniste et critique scripturaire
A. Del Prete
La question de l’auteur/traducteur
Marsile Ficin traducteur de lui-même. Le cas de Christiana Religione
G. Bartolucci
« Politique » dans la terminologie latine de Jean Bodin, auteur des Six livres de la République (1576)
M. Turchetti
« Voces propter res, non res propter voces ». Campanella traducteur de lui-même
G. Ernst
Thomas Hobbes traducteur de lui-même. Les deux versions du Leviathan et les deux procès, du roi et des régicides
M. Turchetti
TRADUIRE LA PHILOSOPHIE
La langue comme outil philosophique
Nāṣir-e Khosrow traducteur des Ikhwān al-Ṣafā’ ?
C. Baffioni
Comenius et le débat sur la langue universelle
A. Cagnolati
Philosophie, magie de la parole, encyclopédie : la Tipocosmia d’Alessandro Citolini
G. Dragnea Horvath
L’art philosophique de la traduction
Les traductions de Machiavel en Angleterre
L. Simonutti
« Aller au fond des pensées ». Giordano Bruno et les traductions
S. Bassi
L’instruction des princes dans l’Europe du XVIIe siècle : la traduction italienne (1677) des écrits pour le prince de La Mothe Le Vayer
L. Bianchi
Sorbière traducteur de Hobbes : l’irruption du politique en traduction
F. A. Cappelletti
Les Platoniciens de Cambridge traducteurs
J.-L. Breteau
Le cas Descartes
Les mots et les pensées. Sur la première traduction latine du Discours de la Méthode
M. Spallanzani
Descartes : traduction, vérité et langue universelle
G. Belgioioso
Descartes et la traduction latine de la morale par provision
L. Delia
La part de Descartes dans la traduction de ses oeuvres : Du Discours de la Méthode a la Dissertatio de Methodo
D. Donna
Spinoza « traducteur » des Principia philosophiae cartesii
C. Santinelli
Traduction et théorie du langage : pratique de la traduction
Verbum sermo ratio. Lectures hétérodoxes du logos de Jean entre les XVIIe et XVIIIe siècles
S. Brogi
Leibniz et la traduction universelle
M. Favaretti Camposampiero
Théorie du langage et philosophie de la traduction chez Christian Wolff
M. Favaretti Camposampiero
Traduction et théorie du langage chez Locke
J.-M. Vienne
Locke traducteur de Nicole : Of the Weaknesse of Man
L. Simonutti
Vico, traducteur de Le Clerc
F. Lomonaco
VERS UNE PHILOSOPHIE DU TRADUIRE : HERMÉNEUTIQUE ET CRITIQUE
Traduction et tradition
Les Epistola pseudo-hippocratiques. Entre traduction, tradition et translation
P. Schiavo
Lucrèce en Angleterre. Echos et traductions du poème lucrétien au XVIIe siècle en Angleterre
D. Pfanner
L’image de l’islam au XVIIIe siècle entre érudition et vulgarisation. Notes sur la traduction française du De religione mahommedica d’Adriaan Reeland
R. Minuti
Antiquité, modernité, traduction
Terrible merveille
E. Barilier
Une Antiquité controversée et diversement adaptée : l’Ars poetica d’Horace dans les commentaires et la poétique des XVIe et XVIIe siècles
S. Richter
Vers la modernité
La question de l’équivalence dans la traduction
F. Ervas
Vingt ans après : Alexander von Humboldt se réécrit et se traduit lui-même
S. Poggi
Wilhelm von Humboldt et le paradigme de la traduction
I. Ferron
INDEX des noms
S'interroger sur le point de vue du traducteur, dans la mesure où le sens produit en dépend, représente une démarche essentielle de l'étude de la pratique de la traduction. En effet, Nietzsche n'a pas lu Epicure comme Gassendi, Avicenne n'entendait pas Aristote comme Heidegger. La place du lecteur dans un espace-temps donné est fondamentale pour l'interprétation du sens d'un énoncé. L'Histoire apparaît ainsi comme ce qui définit une communauté ou une séparation d'univers et de discours, entre l'auteur et son lecteur.
Traduction et Histoire vont de pair au niveau théorique, et s'il est une chose qu'enseigne l'étude de l'histoire des traductions, c'est que la pluralité des lectures l'emporte toujours sur l'unité sémantique d'un texte. La nécessité de retraduire encore et encore certaines œuvres met clairement en évidence ce phénomène.
Si l'une des questions théoriques essentielles de la traduction est de s'interroger sur le sens des énoncés, question pressante en philosophie, il faut, pour comprendre ce qu'est traduire, inscrire la réflexion dans l'Histoire, mettre à jour et rendre intelligible le lien originel entre la question du sens des énoncés et celle de ses variations dans le temps. Cet ouvrage, contenant une quarantaine de contributions traitant de projets de traduction des XVIe-XIXe siècles, à partir du grec, du latin, de l'hébreu, de l'arabe, du français ou de l'italien, s'y engage.
Dans une large mesure, le travail des traducteurs, tant d'un point de vue philosophique qu'historique, a contribué à former la personnalité de l'Occident. Par rapport au texte original, la traduction parfois adoucit les traits, parfois les charge, parfois exagère une expression ou en atténue une autre, semblable en cela aux travestissements des fêtes ; car la lecture est une fête : elle l'a été de la Renaissance aux Lumières, et la traduction, elle, fut à maints égards le visage même de plusieurs auteurs. En une formule, elle fut souvent le masque de l'écriture.
TABLE DES MATIÈRES
Remerciements
Avant-propos
Et je ne portai plus d’autre habit
Le vêtement signe
Texte, texture
La vie, la mort, naissance et résurrection
La République de Platon : Er l’Arménien
Le livre X de la République
Postel, Winslow, Grotius
L’Arménien au fil des lectures
Lectures d’enfance
Autres lectures
Le bonnet d’Arménien: Rousseau libre, mage et divin
L’affranchi
Le magicien
Polyeucte
Le dieu Lunus
« Plus d’à moitié femme », le dieu androgyne et le tissage social
Le commerçant et le religieux : la « xéniteia » de Rousseau
Errant, étranger et étrange
Le moine errant oriental
Le commerçant
Commerce et religion
Remonter au Déluge
Poussin et le Déluge
Vies parallèles
Rousseau spectateur du Déluge
Henri Meister
François Favre et Bernardin de Saint Pierre : la figure maternelle
Madame d’Epinay
Temps et lieux : Rousseau dans le paysage arméno-suisse
Déluge et mélancolie : de l’urine et des larmes
De Chardin à la Lycanthropie
Transmutation et dédoublement : Er l’Arménien, encore
La peinture de Ramsay, le cyclope et le bonnet de Rabelais
Caractère musical : l’Arménien de Venise ou le moi neutre
Hospitalité en guise de conclusion
Liste des illustrations – crédits photographiques
Index
Rousseau décida un jour de s’habiller en Arménien. Il déclara : « Et je ne portai plus d’autre habit ». Il était nécessaire d’examiner ce choix vestimentaire décisif à la lumière de l’œuvre, incluant l’expérience vécue et les lectures du philosophe, pour montrer que loin de ressortir au caprice ou à l’utilitaire, loin d’être anecdotique, l’habit arménien s’accorde avec l’univers de pensée de Rousseau. C’est l’habit qu’il habite.
Les différentes dimensions symboliques de l’habit arménien examinées ici confèrent à ce choix vestimentaire une valeur de signe, éclairant les questions philosophiques et politiques cruciales aux yeux de Rousseau : l’immortalité de l’âme, le commerce entre les hommes. L’habit arménien recouvre le moi physique, imaginaire, musical et spirituel du citoyen de Genève, il lui procure l’aura du mage, l’animalise et le divinise tout à la fois. Seul l’habit arménien aura montré Rousseau dans toute la vérité de sa nature et l’aura désigné comme ce qu’il est : « autre ».
Mots-clés : vêtement, arménien, bonnet, lycanthropie, déluge, immortalité de l’âme, commerçant, moine, résurrection, représentation.
Table des matières
« Editorial » par Jacques Berchtold ; « Editer Rousseau : histoire, problèmes, perspectives » Présentation par Gauthier Ambrus et Erik Leborgne ;
I. – L’atelier éditorial : identification des manuscrits, établissement des textes, édition d’inédits.
La Muse allobroge, 1742, florilège autographe des écrits de jeunesse de Jean-Jacques Rousseau par Jean-Daniel Candaux ; Rousseau secrétaire de Mme Dupin : l’article 2 de l’ Ouvrage sur les femmes : « De la Génération » par Frédéric Marty ; La fabrication posthume des Fragmens pour un dictionnaire des termes d’usage en botanique et son attribution à Rousseau par Alexandra Cook ; Les « Leçons de musique » du fonds Rousseau de la bibliothèque de Genève, manuscrit autographe du traité de composition inédit de J.-Ph. Rameau : « L’Art de la basse fondamentale » par Claude Knepper et Isabelle Rouard ; Un fragment inédit de Rousseau sur l’état de société, texte établi et présenté par Bruno Bernardi ; Une vingt-huitième carte à jouer, texte établi et présenté par Alain Grosrichard et François Jacob ; Le manuscrit des additions de Pierre Prévost aux Fragments d’observations sur l’Alceste de Gluck texte établi et présenté par Gauthier Ambrus ;
II – Réflexions sur l’histoire des éditions. Fidèles à Rousseau ? Le cas des premiers éditeurs des Confessions par Shojiro Kuwase ; Editer Rousseau sous la Restauration : le grand oeuvre de Musset-Pathay par Philip Stewart ; Le Dictionnaire de musique de J.-J. Rousseau : chronique d’une aventure éditoriale par Claude Dauphin ;Une préface pour les Confessions (1780) texte établi et présenté par Gauthier Ambrus ;
III – Editer Rousseau aujourd’hui. Lire et éditer Rousseau : genèse des textes et invention conceptuelle
par Bruno Bernardi ; Notes philologiques et interprétatives des Confessions : les choix de l’éditeur
par Jacques Berchtold, Erik Leborgne et Yannick Séité ; Plaidoyer pour l’annotation interprétative.
Le cas du personnage de Venture dans les Confessions (l. III et IV) par Jacques Berchtold et Erik Leborgne ; Rétrograder avec Jean-Jacques : une édition des manuscrits de Julie, ou La Nouvelle Héloïse par Nathalie Ferrand ; Eléments de réflexion pour éditer la correspondance de J.-J. Rousseau par Anne-France Grenon ;
VARIA. Rousseau et Gluck : poésie et musique dans Iphigénie en Aulide par Yoshihiro Naito ; La réception de Rousseau à Genève à travers ses rapports avec la Bibliothèque de l’Académie par Thierry Dubois ;Une lettre inédite de Rousseau à François-Joseph de Conzié texte établi et présenté par Takuya Koyabashi ; Chronique de la Société J.-J. Rousseau par François Jacob.
Table des matières : « Editorial » par Jacques Berchtold ; « Editer Rousseau : histoire, problèmes, perspectives » Présentation par Gauthier Ambrus et Erik Leborgne ;
I. – L’atelier éditorial : identification des manuscrits, établissement des textes, édition d’inédits.
La Muse allobroge, 1742, florilège autographe des écrits de jeunesse de Jean-Jacques Rousseau par Jean-Daniel Candaux ; Rousseau secrétaire de Mme Dupin : l’article 2 de l’ Ouvrage sur les femmes : « De la Génération » par Frédéric Marty ; La fabrication posthume des Fragmens pour un dictionnaire des termes d’usage en botanique et son attribution à Rousseau par Alexandra Cook ; Les « Leçons de musique » du fonds Rousseau de la bibliothèque de Genève, manuscrit autographe du traité de composition inédit de J.-Ph. Rameau : « L’Art de la basse fondamentale » par Claude Knepper et Isabelle Rouard ; Un fragment inédit de Rousseau sur l’état de société, texte établi et présenté par Bruno Bernardi ; Une vingt-huitième carte à jouer, texte établi et présenté par Alain Grosrichard et François Jacob ; Le manuscrit des additions de Pierre Prévost aux Fragments d’observations sur l’Alceste de Gluck texte établi et présenté par Gauthier Ambrus ;
II – Réflexions sur l’histoire des éditions. Fidèles à Rousseau ? Le cas des premiers éditeurs des Confessions par Shojiro Kuwase ; Editer Rousseau sous la Restauration : le grand oeuvre de Musset-Pathay par Philip Stewart ; Le Dictionnaire de musique de J.-J. Rousseau : chronique d’une aventure éditoriale par Claude Dauphin ;Une préface pour les Confessions (1780) texte établi et présenté par Gauthier Ambrus ;
III – Editer Rousseau aujourd’hui. Lire et éditer Rousseau : genèse des textes et invention conceptuelle
par Bruno Bernardi ; Notes philologiques et interprétatives des Confessions : les choix de l’éditeur
par Jacques Berchtold, Erik Leborgne et Yannick Séité ; Plaidoyer pour l’annotation interprétative.
Le cas du personnage de Venture dans les Confessions (l. III et IV) par Jacques Berchtold et Erik Leborgne ; Rétrograder avec Jean-Jacques : une édition des manuscrits de Julie, ou La Nouvelle Héloïse par Nathalie Ferrand ; Eléments de réflexion pour éditer la correspondance de J.-J. Rousseau par Anne-France Grenon ;
VARIA. Rousseau et Gluck : poésie et musique dans Iphigénie en Aulide par Yoshihiro Naito ; La réception de Rousseau à Genève à travers ses rapports avec la Bibliothèque de l’Académie par Thierry Dubois ;Une lettre inédite de Rousseau à François-Joseph de Conzié texte établi et présenté par Takuya Koyabashi ; Chronique de la Société J.-J. Rousseau par François Jacob.
Table des matières
Remerciements
Avant-propos
Introduction
Abréviations
Première partie: LES MENUS-PLAISIRS DU ROI
I. L'organisation des grandes fêtes à l'époque de Louis XVI
II. Les ordonnateurs
III. Les artistes
Seconde partie: LES GRANDES FÊTES ET CÉRÉMONIES
Les Fêtes de la Paix à l'occasion de la fin de la Guerre de Sept Ans en juin 1763
La cérémonie de la Pose de la première pierre de l'église de Sainte-Geneviève, à Paris, le 6 septembre 1764
L'inauguration de la statue pédestre de Louis XV, à Reims, du 26 au 28 août 1765
Le Mariage de Louis, Dauphin de France et de Marie-Antoinette, Archiduchesse d'Autriche en mai 1770
I. Préambule
II. Le voyage
a) De Vienne à Strasbourg
b) Strasbourg
c) Saverne
d) Nancy
e) Châlons-sur-Marne
f) Soissons
g) De Compiègne à Versailles
III. Les Fêtes de Versailles
IV. Les Fêtes de Paris
Le Sacre de Louis XVI en la cathédrale de Reims, le 11 juin 1775
La Naissance de Madame Royale, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, le 19 décembre 1778
La Pompe funèbre de l'Impératrice Marie-Thérèse à Notre-Dame de Paris, le 31 mai 1781
Les réjouissances pour la Naissance du Dauphin, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, en 1781 et 1782
Les fêtes organisées à Paris à l'occasion de la Paix signée entre la France et l'Angleterre à la suite de la Guerre de l'Indépendance des Etats-Unis d'Amérique, en décembre 1783
L'Assemblée des Notables et la salle provisoire des Menus-Plaisirs à Versailles en 1787
La salle des Etats-Généraux et la Cérémonie d'ouverture les 4 et 5 mai 1789
La Fête de la Fédération, le 14 juillet 1790
Conclusion
Troisième partie: CATALOGUE GÉNÉRAL DES FÊTES FRANÇAISES DE 1763 A 1790
Table et commentaire des illustrations
Les sources
Bibliographie
Index